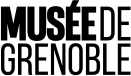La Vallée du Grésivaudan

« La nature avant tout, la nature en elle-même et avec toutes ses variétés de collines, de pentes, de vallées, de clochers à distance ou de ruines, la nature surmontée d’un ciel haut, profond et chargé d’accidents, voilà le paysage comme l’entend Monsieur Huet »[1]. C’est ainsi que Charles-Augustin Sainte-Beuve résume l’art de Paul Huet, paysagiste romantique, ami de Delacroix, sachant capter dans ses peintures la poésie grandiose et mélancolique d’un site plongé dans les tourbillons d’une tempête ou le fracas d’un orage. Mais l’artiste est aussi considéré comme un des précurseurs de l’impressionnisme, pratiquant très tôt le travail en plein air dans des aquarelles d’une grande liberté de traitement, aux tonalités lumineuses, annonciatrices du travail d’Eugène Boudin et Johan Barthold Jongkind. C’est auprès de son ami et condisciple dans l’atelier du baron Gros, Richard Parkes Bonington, que Paul Huet s’initie à cette technique très en vogue en Angleterre. Infatigable voyageur, Paul Huet sillonne la France, la Normandie et l’Auvergne, le Pays niçois et les Pyrénées, faisant quelques incursions en Italie et en Angleterre, à la recherche du site pittoresque, du coin de nature remarquable, qu’il noie dans une lumière souvent brumeuse. Peu encombrant, le matériel d’aquarelliste lui permet de fixer ses impressions rapidement : « Je ferai une tournée à pied avec seulement une boîte d’aquarelle et mon carnet de croquis », raconte-t-il à sa sœur Mme Richomme alors qu’il se trouve en Normandie en 1828. L’artiste séjourne en Dauphiné durant les mois d’été de 1858, découvrant avec émotion l’atmosphère oppressante des vallées de montagne, résonnant du fracas des torrents. Il visite le château de Vizille et surtout la grande Chartreuse qui lui laisse une impression profonde. Il retrouve à Grenoble son cousin Auguste Petit[2], président de chambre à la Cour d’appel de Grenoble. Les deux hommes entretiennent une correspondance suivie jusqu’à la mort de Paul Huet, échangeant des propos sur l’art et en particulier sur Delacroix[3]. Dans cette aquarelle de la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, Paul Huet parvient à traduite, avec une étonnante économie de moyens, l’impression d’espace largement ouvert de cette vallée plate dont l’horizon se heurte pourtant au rempart bleuté des montagnes de la chaîne de Belledonne. Vaporeuse, la crête rocheuse se noie au loin dans un ciel liquide, baigné de lumière. Les arbres et la chaumière, plus denses, donnent l’échelle du paysage. Paul Huet dans une lettre à sa nièce analyse ainsi la difficulté à saisir les différents plans d’un tel site : « Ici, la vallée que nous occupons a bien assez d’espace pour offrir des vues ; […] mais les montagnes (…) sont de vraies murailles dont la couleur, d’un vert absolu, diminuerait beaucoup la hauteur, si l’œil n’était obligé de la mesurer en se levant sans cesse vers le ciel »[4]. Le musée de Grenoble possède une autre aquarelle de Paul Huet, réalisée à Honfleur (MG 1776 ), provenant de la collection Mesnard.
[1] Charles-Augustin Sainte-Beuve, « Paul Huet », in Portraits contemporains, t. II, p.243,- article paru dans Le Globe (23 octobre 1830) sur le diorama Montesquieu : Vues de Rouen et du château d’Arques, p.244-245.
[2] Membre de l’Académie delphinale depuis 1860 jusqu’à sa mort en 1886, auteur d’une notice consacrée au peintre grenoblois Diodore Rahoult, lue à l’Académie delphinale en 1874. Il a vendu et donné plusieurs dessins anciens au musée de Grenoble en 1878.
[3] Lettre de Paul Huet à Auguste Petit du 16 février 1864, au moment de la mort de Delacroix.
[4] Lettre de Paul Huet à sa nièce Caroline du 14 septembre 1858.
Découvrez également...
-

-

Femme s'habillant
1918 - 1920 -

Vue de l'Ile Barbe à Lyon
XIXe siècle