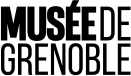Alina Szapocznikow. Langage du corps
Aujourd’hui considérée comme l’une des artistes majeures du XXe siècle, Alina Szapocznikow (1926 à Kalisz, Pologne – 1973 à Passy en Haute-Savoie) a rarement fait l'objet d'expositions dans son pays d’adoption, la France. Le musée de Grenoble présente, en partenariat avec le Kunstmuseum Ravensburg, un parcours de près de 150 œuvres réalisées entre 1947 et 1973. L’exposition Alina Szapocznikow. Langage du corps permet d’appréhender toute la carrière de l’artiste en mettant l’accent sur la période de maturité des années 1960-70. Dans son œuvre, mêlant érotisme et traumas, le corps est le principal sujet d’inspiration. Sculptrice, elle s’attelle à toutes sortes de matériaux, aussi bien classiques, que plus novateurs, résine de polyester et mousse de polyuréthane. Héritière du Surréalisme, contemporaine des artistes du Nouveau Réalisme, elle contribue avec indépendance, en seulement deux décennies, au renouveau de la sculpture.
Troublante, bizarre, baroque, existentielle, informe et érotique, l’œuvre de la sculptrice polonaise Alina Szapocznikow, longtemps incomprise, échappe à la classification. Consacrant son œuvre au corps, elle exprime à travers lui tant la puissance de l’érotisme que la fragilité de nos existences. L’exposition se déployant en 15 salles se subdivisera en deux parties. La première sera consacrée à ses années de création à Prague (1945-1951) et en Pologne (1951-1962). La deuxième sera dédiée à celles passées dans le Paris des années 1960 entre 1963 et 1973.
Juive, Alina Szapocznikow survit, adolescente, à la Shoah et à sa détention dans les camps de concentration. Après la Seconde Guerre mondiale, elle mêle un langage formel marqué à la fois par le modernisme tchèque, le Surréalisme et l’art informel, à l’esthétique du Réalisme socialiste, répond à des commandes publiques, et donne corps à des créations marquées par une forme d’existentialisme.
Alina Szapocznikow réalise l’essentiel de son œuvre de maturité en France où elle s’installe définitivement en 1962. Avec son mari le graphiste Roman Cieslewicz, elle s’attelle à déconstruire la figure humaine. Le corps fragmenté devient le cœur de sa production sculpturale et graphique. Inventant une forme de grammaire érotique, une mythologie personnelle où le désir côtoie la mort, l’artiste conjure ses peurs, exorcise ses traumatismes. À travers ses Lampes-bouches, la série des Desserts et des Ventres-coussins, elle développe une production en série formée de fragments corporels sensuels et troublants, interrogeant la place de la femme dans la société des années 1960. Son intérêt pour l’informe et le hasard s'incarne aussi dans l’ensemble des Photosculptures (1971) dans lesquelles des chewing-gums mastiqués par l’artiste elle-même sont photographiés comme des sculptures traditionnelles. À partir de 1969, atteinte d’un cancer du sein, Szapocznikow, se focalise sur la mémoire, les traumas et la finitude dans sa série Souvenirs (1970-1971) puis dans celle des Tumeurs (1969-1972). Constituées de résine, de photographies froissées, de journaux et de la gaze, ces œuvres évoquent la maladie. Elles témoignent aussi de l’inébranlable courage et de la vitalité artistique qui n’ont cessé d’animer l’artiste.
Par la singularité comme par l’érotisme qui imprègne son œuvre, l’artiste a été comparée à Louise Bourgeois et à Eva Hesse. Il s’agit de mettre en lumière l’œuvre d’une femme artiste pionnière longtemps négligée par l’histoire de l’art.
 Alina Szapocznikow, Goldfinger, 1965
Alina Szapocznikow, Goldfinger, 1965
Assemblage de ciment, patine et métal
Museum Sztuki w Ludzi / Musée d'art de Łódź, Pologne
© ADAGP, Paris 2025. Courtesy The Estate of Alina Szapocznikow | Galerie Loevenbruck, Paris | Hauser & Wirth
Crédit photo : Musée d'art de Łódź, Pologne