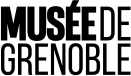Trois-mâts dans la brise
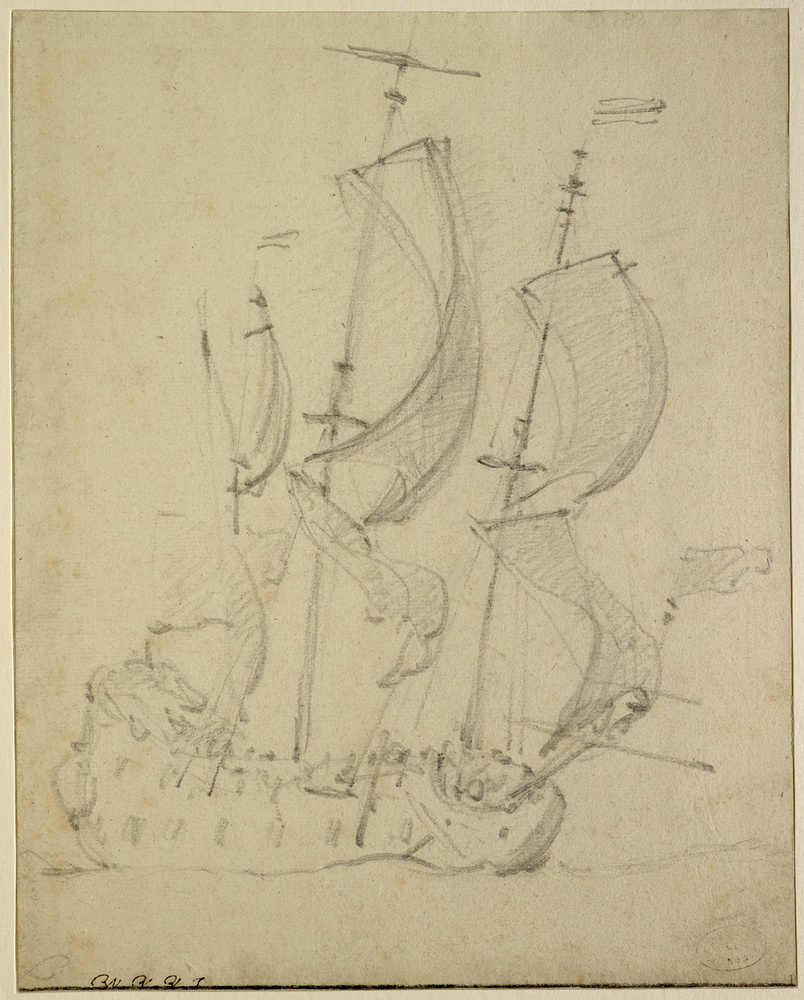
Willem van de Velde le Jeune est sans nul
doute aujourd’hui le peintre de marines hollandais
le plus connu et le plus apprécié. La
qualité mais aussi la quantité de ses oeuvres
n’y sont pas étrangères. Dès le XVIIIe siècle, on
trouve des tableaux de sa main dans toute
bonne collection d’art nordique qui se respecte.
Grand peintre, Willem van de Velde est
aussi un excellent dessinateur, à l’instar de son
père. Ce dernier s’illustre dans la production
de surprenants penstukken ou « tableaux à la
plume » (parfois de très grande taille) réalisés
à l’encre noire sur un support préparé en
blanc, qui semblent être d’immenses dessins
ou gravures. Après avoir parfait son apprentissage
auprès du peintre de marines Simon
de Vlieger (1600/1601-1653), qui lui enseigne
l’art du coloris, Willem le Jeune retourne dans
l’atelier de son père. Les deux artistes devaient
continuer de collaborer jusqu’au décès de ce
dernier en 1693[1].
Si l’année 1672 demeure gravée dans l’histoire
des Pays-Bas comme le rampjaar, « l’année de
la catastrophe », c’est en revanche dans la carrière
des Van de Velde un tournant très favorable.
Les deux peintres quittent la Hollande
durant, ou juste après, les derniers mois de
cette année et s’installent en Angleterre où le
roi Charles II (1630-1685) met immédiatement
à leur disposition un atelier à Greenwich.
Il leur assure même, à partir de 1674, une pension
annuelle. La faveur royale ne dure que le
temps du règne des Stuarts. Après le décès de
Jacques II en 1688, le Hollandais Willem III qui lui succède sur le trône ne semble pas
goûter l’art de ses compatriotes et met fin aux
privilèges accordés aux Van de Velde. Ceux-ci
quittent alors Greenwich pour s’installer dans
le centre de Londres et vivent désormais des
ventes de leurs oeuvres sur le marché. Leur
réputation et les contacts multiples qu’ils ont
tissés avec les collectionneurs leur permettent
toutefois de poursuivre confortablement leur
brillante carrière.
Cette belle esquisse à la pierre noire est depuis
longtemps attribuée à Willem van de Velde le
Jeune. Il en existe une autre version, conservée
au National Maritime Museum à Greenwich
qui n’avait jusqu’à aujourd’hui pas été mise
en relation avec le dessin étudié ici[2]. La feuille
en est beaucoup plus grande et le navire y
est représenté avec maints détails supplémentaires.
On distingue notamment les trois
bandes horizontales du pavillon, indiquant
que l’on a ici affaire à un vaisseau néerlandais.
Se basant sur le sujet et la signature, Michael
Robinson, dans sa monumentale étude sur
les dessins des Van de Velde au musée de
Greenwich, datait la feuille vers 1672, c’est-à-
dire de la période hollandaise des peintres.
Ainsi que le note le catalogue en ligne de
cette collection, on ne peut cependant dater
les oeuvres des Van de Velde sur la seule foi
du sujet représenté car les artistes, après leur
installation à Londres, continuent à représenter
des navires de leur patrie d’origine et ce,
même durant la troisième guerre anglo-néerlandaise
(1672-1674).
Le filigrane que porte le papier du dessin de
Greenwich est le même que celui de la feuille
de Grenoble[3]. Il est aujourd’hui plutôt daté
autour de 1691[4], ce qui repousse l’exécution
probable de nos oeuvres de près de vingt ans,
à une époque où les Willem van de Velde père
et fils ont depuis longtemps émigré en Angleterre.
La datation précède de peu le décès du
père mais on sait que celui-ci demeure actif
jusqu’à l’extrême fin de sa vie.
Le lien entre les deux dessins, s’il est incontestable,
n’est pas clair. L’oeuvre de Greenwich est
certes plus détaillée que la version grenobloise,
mais l’exécution est très enlevée dans un cas
comme dans l’autre. Elles présentent chacune
cette liberté que l’on trouve souvent dans les
esquisses à la pierre noire des Van de Velde.
Aucun des deux dessins ne saurait dont être
une copie de l’autre.
De plus, ils portent tous deux le monogramme
appliqué à l’encre de Willem van de Velde le
Jeune. Selon Robinson, celui-ci l’apposa sur
des feuilles de l’atelier – également sur celles
de son père – lorsqu’il cherchait à les vendre[5].
L’auteur suppose que c’est lors de périodes de
difficultés financières qu’il se dessaisit de ces
dessins. Les recherches de Remmelt Daalder
tendent toutefois à montrer que l’entreprise
des Van de Velde n’a pas connu de telle récession[6].
Il devait tout simplement y avoir sur le
marché de l’art une forte demande pour les
feuilles des célèbres peintres de marines.
Les dimensions des tracés étant différentes
dans les deux dessins, il ne peut pas non plus
s’agir d’un original et de son « offset ». Les
Van de Velde ont souvent utilisé cette technique
qui consistait à réaliser une première
contre-épreuve[7], la compléter puis en tirer une
seconde afin de « retourner » le navire et obtenir
ainsi un troisième dessin, dans le même
sens que le premier[8]. Ils pouvaient par la suite
utiliser l’offset mais aussi la contre-épreuve
afin de retravailler les portraits de bateaux
pour les besoins d’une composition.
On a sans doute ici plutôt affaire à une autre
procédure utilisée par les Van de Velde. En
échange des pensions annuelles versées par
le roi Charles II aux deux peintres à partir de 1674, il est stipulé que le père devait réaliser des
dessins de batailles navales (drafts of seafights)
et le fils mettre ceux-ci en couleurs (putting
the said drafts of seafights into colours), c’està-
dire en faire des tableaux[9]. Pourrait-on avoir
ici la trace d’une telle répartition du travail ?
Le dessin de Grenoble, plus esquissé, a pu être
réalisé par le père, devant le motif[10] ; dans la
feuille de Greenwich, le fils reprend le modèle
et l’agrandit afin de l’utiliser pour un tableau.
Quant aux détails qu’il ajoute au navire dans
cette deuxième version, il a très bien pu les voir
lui-même car on sait qu’il accompagnait souvent
son père en mer.
[1] Aucune preuve ne vient étayer la supposition de Michael Robinson selon laquelle les deux peintres se séparent pour avoir chacun un atelier dans les années 1680. Voir le résumé de la thèse de doctorat de Remmelt Daalder, Van de Velde & zoon, zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge, 1640-1707.
[2] Pierre noire sur papier vergé crème, 37,9 x 26,9 cm, monogrammé en bas à droite à la plume et à l’encre brune : « W.V.VJ. », Inv. PAF6548, Greenwich, Londres, National Maritime Museum ; Robinson, 1958, I, n° 359, ill. p. 326.
[3] Robinson ne donne pas d’indication de dimensions des filigranes qu’il répertorie, mais le catalogue des dessins des Van de Velde au musée Boijmans Van Beuningen fournit cette information (Robinson, 1958, I, p. 207, n° 25 ; Weber, 1979, I, p. 141, n° 25) : 8,6 x 4,8 cm, ce qui correspond aux dimensions du filigrane dans la feuille de papier de Grenoble.
[4] Weber, 1979, I, p. 141, n° 25.
[5] Robinson, 1958, I, p. 25.
[6] Sa thèse de doctorat soutenue à l’université d’Amsterdam en juin 2013 sera publiée dans le courant de 2014. Je remercie Remmelt Daalder de m’avoir communiqué par écrit cette information.
[7] Cette technique consiste à appliquer une feuille de papier vierge sur un dessin, pour en transférer son tracé soit en frottant le verso soit encore en passant sous une presse le dessin et la feuille vierge humidifiée.
[8] C’est du moins la conclusion que je tire de la littérature pour le moins cacophonique sur ce sujet. Si l’on en croit la description de Robinson (1958, I, p. 18) les offsets des Van de Velde sont tout simplement des contre-épreuves, mais il évoque aussi des offsets dans le même sens que l’original (1958, II, no 1050, p. 30). Pour Westby Percival-Prescott (dans cat. exp. Hambourg, 1981, p. 19), l’offset était non pas la contre-épreuve d’une contre-épreuve, mais la contreépreuve d’une copie que l’artiste faisait de son propre dessin. Enfin, le catalogue de la collection de Rotterdam (Weber, 1979) évoque sans distinction des offsets dans le même sens et en sens inverse.
[9] Robinson, 1958, I, p. 12.
[10] De nombreuses études à la pierre noire de sa main, conservées à Rotterdam, présentent en effet cette même vivacité de trait, ces rondeurs dans l’esquisse et ces hachures pour les parties ombrées.
Découvrez également...
-

-

Assiette circulaire
milieu de XVIIIe siècle -

Mosaïque Rosaces
début IIIe siècle