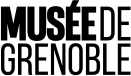Marie-Madeleine au pied de la Croix

Né à Clèves en Allemagne, Govert Flinck s’est
formé dans les Provinces-Unies auprès de deux
maîtres : Lambert Jacobsz, dès 1629 environ,
et Rembrandt, trois ans plus tard. Le premier
appartient, comme Flinck, à la petite mais
influente secte mennonite. Installé à Leeuwarden
en Frise, Jacobsz est surtout renommé pour
ses peintures religieuses qui se distinguent par
une grande clarté et un grand dépouillement.
Dès 1632, Flinck est chez Rembrandt à Amsterdam
pour achever et compléter ses études.
Ce dernier le marque d’une façon décisive
dans un premier temps, alors que dans les
années 1640, suivant le changement de goût
artistique dans les Provinces-Unies, Flinck
délaisse progressivement le style de son maître
– surtout son humanisation des personnages historiques – pour adopter la tradition flamande,
plus idéaliste. La Madeleine inédite de
Grenoble, exécutée à la fin des années 1640,
marque plus encore la transition entre l’art de
Rembrandt et l’intérêt grandissant du peintre
hollandais pour l’art flamand. Une Madeleine
de Flinck de 1657, conservée dans une collection
particulière, montre bien comment l’artiste
s’est approché à la fin de sa vie de l’art
pathétique et plein d’émotion de Rubens[1].
En 1652, Flinck obtient le droit de bourgeoisie
à Amsterdam, ce qui lui permet de travailler
dès 1655 pour l’hôtel de ville et de signer, en
novembre 1659, une des plus prestigieuses
commandes du temps : l’exécution de douze
grands tableaux d’histoire pour la salle centrale
d’apparat. La mort du peintre, deux mois plus tard – considérée en Hollande comme
une grande perte pour la peinture – l’empêche
de les réaliser et oblige la municipalité à redistribuer
la commande.
Une des plus grandes découvertes des dernières
années, concernant Rembrandt et ses
élèves, est vraisemblablement le corpus des
paysages de Govert Flinck, attribués auparavant
avec beaucoup de certitude à Rembrandt.
Dans l’oeuvre riche et varié de Flinck, la puissance
de l’effet se joint à une grande délicatesse
dans la représentation des sentiments, comme
le montre le dessin de Grenoble. Exécutée à
la pierre noire et rehaussée de craie blanche
sur papier bleu, la feuille est signée en toutes lettres, ce qui fait penser qu’elle fut destinée à
la vente comme de nombreux autres dessins
de l’artiste. La feuille est préparatoire à une
Madeleine au pied de la Croix, visible dans une
Crucifixion de Flinck conservée au Kunstmuseum
de Bâle[2] (Golgotha, Inv. n°212). Dans l’iconographie
chrétienne, Madeleine est agenouillée aux
pieds du Christ et embrasse la Croix.
Un beau dessin de Flinck, conservé au Teylers
Museum à Haarlem, a été considéré par Peter
Schatborn comme une oeuvre préparatoire
au tableau de Bâle[3] (Jeune homme assis, Inv. n°P+007). Il représente
l’un des jeunes hommes jouant aux dés pour
gagner la tunique du Christ, au premier plan
à gauche. Si on note des similitudes entre les deux hommes, l’hypothèse d’un dessin préparatoire
pour le tableau de Bâle est moins
convaincante que dans le cas de la Madeleine
de Grenoble, pour laquelle il n’existe aucun
doute. Seule différence notable entre le dessin
et la peinture, la représentation de Madeleine
est inversée. La peinture sur bois de Bâle,
d’environ un mètre de haut et cintrée dans la
partie supérieure, est signée et datée de 1649,
selon les recherches des ateliers de restauration
de Bâle entamées en 1965[4]. L’oeuvre est clairement
influencée par le cycle sur la Passion
de Rembrandt, destiné au prince d’Orange et
exécuté entre 1634 et 1639, mais Sumowski
remarque que le coloris chaud, ainsi que le
dessin des figures, évoque plutôt l’art flamand
(on pourrait penser à certaines oeuvres de Jordaens).
Flinck s’est déjà inspiré de ce cycle de
Rembrandt, notamment dans une Déploration
au pied de la Croix de 1637, conservée au
Museum of Western Art à Tokyo[5] et la comparaison
entre les deux oeuvres permet de voir
l’évolution de Flinck durant les douze années
qui séparent les deux tableaux. Il atténue,
dans le tableau de Bâle, l’aspect humain de
l’histoire sacrée et crée une composition plus
harmonieuse. D’autres artistes se sont inspirés
de ce même cycle de Rembrandt, dont Jan van
Noordt, dans une Crucifixion conservée à Avignon,
très proche de celle de Bâle[6].
Les lignes fluides qui dessinent le manteau et
le foulard de la Madeleine enveloppent entièrement
son corps. L’expression de la douleur
sur son visage et les mains enlaçant la Croix
(qui se substitue au Christ tant aimé par
Madeleine) sont rembranesques, alors que la
technique, à la pierre noire et à la craie blanche
sur papier bleu, rappelle l’art d’un Jacob Backer,
un autre élève de Lambert Jacobsz. L’attention
portée à l’étude des figures, qui sont
minutieusement décrites sur de grandes
feuilles, est partagée aussi bien par les élèves
de Rembrandt comme Flinck et Bol que par
Backer et les artistes de son cercle, comme Jan
van Noordt, Jacob van Loo ou encore Nicolas
van Helt Stockade.
[1] Cat. exp. Stockholm, 1992-1993, n° 86, repr.
[2] Voir Sumowski, 1983, II, n° 630, repr.
[3] Voir Schatborn, 1974, p. 116.
[4] Voir Boerlin, 1987, p. 114 ; le dernier chiffre a été lu parfois de façon différente.
[5] Museum of Western Art, Inv. no P. 2006.0001 ; voir Sumowski, 1983, II, n° 612, repr.
[6] Avignon, musée Calvet, Inv. n° 833.1 ; voir cat. exp. Avignon, 2006-2007, n° 78, repr., et De Witt, 2007, n° 15, repr. ; les deux notices sont complémentaires.
Découvrez également...
-

La Nativité et le couronnement de la Vierge
vers 1375 - 1380 -

Plat circulaire sur talon
XIXe siècle -

Vase en forme de gourde
2ème moitié XVIIIe siècle