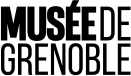Les Trois bohémiens

Né à Bourgoin en 1823 dans un milieu aisé,
Alfred Bellet du Poisat effectue sa scolarité
à Lyon où sa famille s’installe vers 1830. Très
tôt, il manifeste des dispositions pour la peinture
et dès l’âge de seize ans s’initie auprès
d’Auguste Flandrin, puis de Louis Lacuria. Vers
1841, répondant au désir de ses parents, il
entame des études de droit à Paris, domaine
qu’il délaisse rapidement au profit d’une
formation artistique dans l’atelier de Michel
Martin Drölling, puis à partir de 1845 à l’École
des beaux-arts, tout en fréquentant par
ailleurs Hippolyte Flandrin. Il retourne à Lyon
en 1847 où il séjournera jusqu’en 1868, date
à laquelle il s’installe définitivement à Paris.
C’est lors de son retour à Lyon qu’il expose
pour la première fois au Salon de la Société des
amis des arts, salon auquel il participera régulièrement,
avant de faire un premier envoi au
Salon parisien en 1857.
Bien que formé, avec les Flandrin notamment,
selon les principes ingresques d’une peinture
soumise aux règles du dessin, Alfred Bellet
du Poisat s’affirme dès ses débuts par un
style redevable avant tout de l’influence de
Delacroix. Une touche épaisse et fougueuse,
des effets de lumière théâtraux, des formes
façonnées par la couleur sont autant de traits
qui caractérisent sa manière et l’inscrivent
dans la lignée du maître du romantisme. Elle
est mise au service des sujets les plus variés, de
l’évocation d’épisodes historiques aux scènes
de genre en passant par la peinture religieuse.
Cette diversité iconographique désorientera
ses contemporains et sera souvent assimilée
à la liberté d’esprit et l’individualisme de l’auteur.
Elle s’atténuera cependant vers la fin des
années 1860 lorsque le peintre, sous l’influence
de François Auguste Ravier, se consacrera de
plus en plus au paysage dans un style proche
de l’impressionnisme naissant et, à l’instar de
Manet, aux scènes de la vie moderne. Artiste
insaisissable, talentueux et insatisfait, il laissera
à sa mort en 1883, un oeuvre marqué du
sceau de l’éclectisme, traversé de belles intuitions
que des aspirations contradictoires ne
lui auront pas permis de conduire à leur terme.
Les Trois Bohémiens peuvent être considérés
comme l’une des peintures les plus ambitieuses
de Bellet du Poisat et certainement
l’une de ses plus belles réussites. Inspiré d’un
poème de Nikolaus Lenau[1], un auteur très
célèbre dans le monde germanique à l’époque,
cette oeuvre se veut être une ode à la liberté et
à l’indifférence aux biens matériels. Sa composition
s’ordonne autour des trois Tziganes,
héros d’une bohème plus rêvée que réelle, qui
occupent le centre du tableau et se détachent
sur un vaste paysage vallonné auquel un ciel
chargé de nuages confère un souffle épique.
L’artiste les a représentés comme pris sur le
vif, alors qu’ils font une halte. L’un a posé ses
cymbales près de lui et dort, un autre que l’on
voit de dos observe au loin tout en fumant,
tandis qu’entre eux, assis sur un rocher et
dominant ses deux compagnons, un joueur de
violon fixe de son regard intense le spectateur.
Par sa place, son attitude, il capte toute
l’attention et donne corps à sa musique qui se
répand dans le tableau telle une onde portée
par la touche mouvementée du peintre. Alfred Bellet du Poisat, grand voyageur et
esprit indépendant, fut à l’évidence très
sensible aux images du poème qu’il semble
avoir illustré presque littéralement, ainsi que
l’on peut le lire :
« Leurs vêtements n’étaient que haillons
Rapiécés d’étoffes bariolées,
Mais tous les trois, libres et fiers,
Se moquaient du monde et des hommes.
Par trois fois ils m’ont montré comment,
Quand la vie pour nous se fait grise,
On la dissipe en fumée, en rêves et en chansons,
Et triplement on la méprise. »
Par sa fougue et son lyrisme, le tableau emporte
l’adhésion et est bien accueilli à l’époque. On
y retrouve bien sûr l’empreinte de Delacroix,
mais les tons assourdis, le réalisme des figures,
l’âpreté du paysage font aussi songer à un autre
grand peintre qui, dans ces années, occupe l’actualité
: Gustave Courbet.
Alfred Bellet du Poisat, dont le parcours artistique
appartient plus à Lyon et Paris, témoigne
néanmoins de son attachement au musée de
Grenoble en léguant à sa mort ce tableau et
trois oeuvres d’autres maîtres.
[1] Die drei Zigeuner (1838).
Découvrez également...
-

(Sans titre)
XXe siècle -

L'Isère, le vieux pont de pierre et le Rabot
1ère moitié XIXe siècle -

Episode de la peste
1842