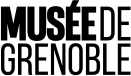Les Cervarolles (Etats romains)

Hébert a trouvé le sujet de son futur tableau
de Salon en observant, à Cervara di Roma, en
Italie, les femmes qui se rendent à la fontaine.
Ces dernières doivent emprunter un sentier
de chèvres pour gagner la source aménagée
à trois kilomètres, en contrebas du bourg.
Leurs allées et venues incessantes, la tête
chargée d’un lourd pot de cuivre (la conca), lui
paraissent inhumaines. Il choisit de les représenter
au moment où elles se rencontrent dans
le village, la plus âgée remontant avec son
récipient plein, les deux plus jeunes descendant
remplir le leur. Certes, ce sont encore des
« filles portant des cruches[1] » comme celles
d’Alvito, précise-t-il à sa mère, mais les villageoises
de ces montagnes affichent un type
maure qu’il veut absolument retenir. Après avoir
esquissé, à Rome, de mémoire et d’après des
études, l’arche du passage couvert de la ruelle
qui constitue l’arrière-plan du tableau, Hébert
décide de retourner à Cervara pour quelques
mois. La grande toile, roulée, est portée à
dos d’âne jusqu’à l’atelier improvisé dans un
petit logement. Il peut désormais accorder
le fond à « ce qu’il a sous les yeux^2 » et
profiter des paysannes qui sont « à sa porte^3 ».
S’il trouve facilement le charmant modèle de
la fillette, celui de la figure principale reste
un problème. Les villageoises, méfiantes,
refusent de poser pour l’artiste. Seule Rosa
Nera, mise à l’écart par ses voisines pour
mauvaise conduite, accepte finalement de se
laisser convaincre. Le modèle lui convient tout
à fait. Mais le mouvement général du tableau
ne lui donne pas satisfaction. Le peintre,
exigeant, reprend régulièrement la toile. Pour
lui, l’enjeu est de taille : il lui faut traduire la
dignité de ces femmes pauvres. Ce n’est qu’au
bout de dix-huit mois d’isolement et de travail
assidu qu’Hébert se décide à quitter le « nid
d’aigle^4 » pour rejoindre la Ville éternelle. Le
tableau, agrandi par le haut, est retravaillé à
Rome où son modèle l’a rejoint. Il sera présenté
au Salon de Paris de 1859. L’achat par l’État
(15 000 francs) pour le musée du Luxembourg
confirme le succès auprès du public. Ces
porteuses d’eau, évoquant les canéphores
antiques et symbolisant les trois âges de la
vie, font l’objet de commentaires critiques
divergents. Arsène Houssaye y voit la vraie
Italie moderne, Théophile Gautier y reconnaît
la beauté, tandis qu’Alfred Castagnary, plus
lucide peut-être, reproche au peintre de se
noyer « dans un océan littéraire[5] ».
Le général de Beylié (1849-1910), dont Hébert
vient de faire le portrait, est le fils d’un de ses
amis d’enfance. Le militaire grenoblois, qui a
grandi dans une famille cultivée, est un collectionneur
et mécène actif qui accumule les objets
depuis vingt ans. Quand il commande à Hébert
un tableau avec l’intention de l’offrir au musée
de Grenoble, à choisir « parmi ses préférés et
typiques[6] », le peintre lui propose Les Cervarolles.
Certes, celui-ci est l’un des plus célèbres, mais
c’est aussi sans doute l’oeuvre de cette période
où il a mis le plus de lui-même : exigeant presque
deux ans de travail sur place, seul face à ses
doutes, l’artiste s’est efforcé de ne pas faire une
scène trop pittoresque et de ne pas courir alors
le risque de paraître anecdotique.
Lors de la commande, Hébert ne cache pas
qu’il compte confier le travail à son élève Félix
et qu’il retouchera les figures. L’artiste n’est
plus en âge de réaliser des toiles de grand
format (même si celle-ci est réduite de moitié)
et il est par ailleurs très pris par des portraits
en cours. Félix est un bon dessinateur, la
reproduction est excellente, mais la touche
est néanmoins plus sèche et bien éloignée du
beau traitement en matière de l’original par
Hébert, présenté au musée d’Orsay.
[1] Lettres à sa mère, 1856-1858, fonds Hébert, musée national Ernest Hébert/musée d’Orsay.
[5] René Patris d’Uckermann, Ernest Hébert : 1817-1908, Paris, Réunion des musées nationaux, 1982, p. 111.
[6] Archives Léon de Beylié, musée de Grenoble.
Découvrez également...
-

-

Dead mask n°17
1975 - 1980 -

Etude d'après nature
3ème quart XIXe siècle