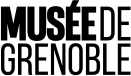Autoportrait à la cravate rouge
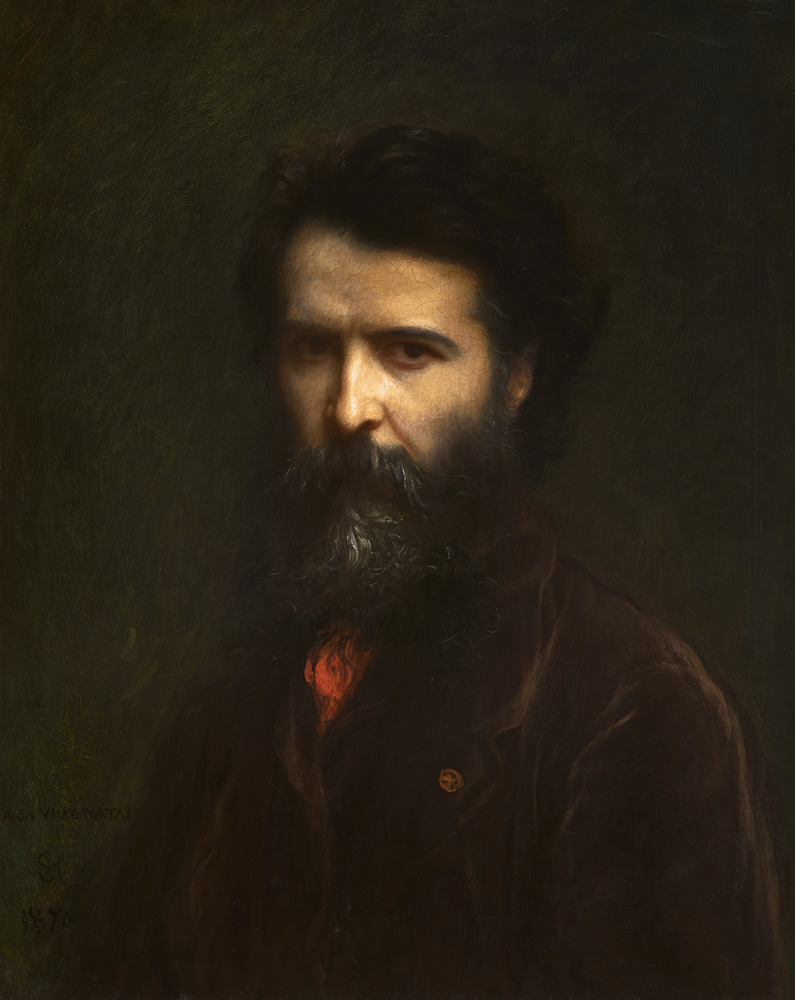
Fils d’un notaire grenoblois, cousin de
Stendhal, Ernest Hébert, né le 3 novembre 1817
à Grenoble, passe une jeunesse studieuse
dans sa ville natale où il prend ses premiers
cours de peinture avec Benjamin Rolland,
conservateur du musée de la ville et professeur
à l’école de dessin.
Formé pendant les années romantiques,
Ernest Hébert commence sa carrière avec la
percée du réalisme. Après une formation classique
à l’École des beaux-arts de Paris, qui le
voit remporter le grand prix de Rome de peinture
historique, il accède à la notoriété avec
La Mal’aria au Salon de 1850. Un bel avenir
s’ouvre alors à lui : il va désormais partager
son temps entre la France et l’Italie, notamment
à Rome où il dirigera à deux reprises l’Académie
de France (1867-1873 et 1885-1890). Il
devient un portraitiste recherché par la haute
société parisienne du Second Empire puis de
la Troisième République. Toutefois, c’est en
Italie qu’il trouve ses sujets de prédilection
en peignant des scènes de la vie paysanne
empreintes d’un réalisme mélancolique.
Sans être, comme Rembrandt ou Courbet,
fasciné par sa propre image, Hébert a jalonné
sa carrière de plusieurs autoportraits, dont
celui-ci qui marque une période glorieuse :
nommé en 1865 directeur de l’Académie de
France à Rome, il a cinquante-trois ans lorsqu’on
lui demande son portrait pour la galerie
des Offices à Florence. Il s’exécute en 1870,
mais la Ville de Grenoble sollicite de son
« éminent compatriote » une faveur égale.
Dans cet autoportrait dédicacé A SA VILLE
NATALE, il se montre à la fois comme un bourgeois,
vêtu de sombre, et comme un artiste
au front dégagé, au regard intense et ténébreux,
tel que l’a décrit son ami Théophile
Gautier : « Avec son teint olivâtre, ses grands
yeux nostalgiques, ses longs cheveux noirs, sa
barbe épaisse et brune, son air profondément
italien, il semble l’idéal et le modèle de ses
propres tableaux[1]. » Sur sa veste de velours
brun, une petite note de couleur est apportée
par la lavallière rouge – allusion discrète à
l’appartenance de sa famille paternelle au
Club républicain – et la rosette de la Légion
d’honneur qu’il a reçue en 1867. La gamme
chromatique employée fait penser à celle de
son ami marseillais Ricard (1823-1873).
Le tableau est une réplique exacte de l’autoportrait
de la galerie des Offices. Depuis les
Médicis, grands collectionneurs, des autoportraits
d’artistes de toutes les nationalités
étaient en effet présentés dans le Corridor
Vasari ; celui-là même qui permettait au grand-duc
de Toscane de quitter, à l’abri des regards
et des dangers, le palais des Offices, au
centre de Florence, pour rejoindre, de l’autre
côté de l’Arno, le jardin Boboli et le palais
Pitti. Sur 1 600 autoportraits, dont ceux de
Raphaël, Holbein, Rubens, Cranach, etc., une
cinquantaine d’artistes français, de Vouet
à Chagall, en passant par David, Delacroix,
Ingres ou Corot, ont accepté d’offrir leur
portrait. Hébert répond donc à son tour favorablement
à la sollicitation du musée, lors du premier directorat (au grand amusement
du peintre, une autre demande fut faite lors
de son second directorat par la commission
qui imaginait sans doute avoir affaire à un
homonyme). Cette reconnaissance du talent
de l’artiste grenoblois, largement relayée par
la presse dauphinoise, éveilla l’intérêt de sa
ville natale qui voulut elle aussi posséder un
portrait du peintre, désormais célèbre, afin
de le léguer à la postérité.
[1] Théophile Gautier, Portraits contemporains, Paris, Charpentier et Cie, 1874, p. 345.
Découvrez également...
-

Stèle à double face
1852 -

Dromadaire
1906 - 1930 -

Pointe de flèche
VIIe siècle av. J.-C. - IVe siècle av. J.-C.