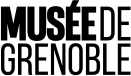(Sans titre)

« La civilisation s’en va petit à petit de moi […]. J’ai toutes les jouissances de la vie libre, animale et humaine. J’échappe au factice, j’entre dans la nature »[1], déclare Paul Gauguin dans Noa Noa, récit quelque peu enjolivé de sa vie à Tahiti rédigé après son retour à Paris. Ce premier séjour en terre maorie dure deux ans, de juin 1891 à juin 1893. Son arrivée à Papeete le déçoit car les traces de la présence coloniale française y sont déjà trop présentes, et c’est donc à quarante-cinq kilomètres de là, dans le petit village de Mataiea, qu’il s’installe pour vivre son rêve de retour aux sources primitives de l’humanité. La vie à Tahiti ne correspond pas toujours à l’image idéalisée qu’il s’en est forgé à Paris avant de s’embarquer[2], mais elle remplit en tout cas son désir – mis en avant pour obtenir du ministère de l’Instruction publique cette mission gratuite pour Tahiti – « d’étudier au point de vue de l’art et des tableaux à en tirer, les coutumes et les paysages de ce pays ». Avant de se lancer dans la réalisation de peintures à l’huile dignes d’être présentées à son retour, Gauguin s’imprègne de la langue, de la culture et de la religion maories, tente de se faire accepter par les Tahitiens et découvre une nature luxuriante, accumulant un matériau documentaire – dessins, notes, croquis – qu’il nomme « documents » lorsqu’il écrit à Paul Sérusier en novembre 1891[3]. Cette très belle feuille, Te Nave Nave Fenua au recto et un poisson jaune au verso, est sans doute un de ces « documents » dont parle Gauguin car elle est le seul feuillet conservé d’un cahier, intitulé Chez les Maories, Sauvageries, dont la couverture est aujourd’hui à l’Art Institute de Chicago. Comme nous l’apprend l’inscription au-dessous du poisson, « L’aquarelle qui se trouve au verso a été achetée / par M. Pietri magistrat, à la vente des œuvres de / feu Paul Gauguin, artiste peintre décédé aux îles / Marquises. Cette aquarelle de Gauguin était dans un / album dont il ne restait que trois feuillets et qui portait / pour titre “Chez les Maories – Sauvageries” ». En effet, lors de la vente après décès de l’artiste qui se tient à Papeete le 2 septembre 1903, M. Georges Pietri, juge au tribunal supérieur de Papeete, se porte acquéreur de deux lots : « n°31. Un cadre » pour vingt francs et « n°125. Un cahier » pour la modique somme de 2 francs[4]. C’est à ce dernier lot que correspond l’album en tapa de Chicago, orné du titre, du monogramme de l’artiste « P G » et de trois dates : « 91 / 92 / 93 ». Un masque maori complète la décoration sur la première de couverture, le dos étant occupé par un oursin rouge et bleu. Ce portfolio est un des trois connus – les deux autres s’intitulent respectivement Documents Tahiti : 1891, 1892, 1893 et Soumin[5]– à avoir été réalisés par Gauguin durant son séjour à Tahiti et non constitués à son retour en France. Le dessin de Grenoble, que l’on peut dès lors dater vers 1892, est donc bien une des premières représentations de l’Ève tahitienne, appelée par la suite à avoir chez l’artiste de nombreuses déclinaisons, en pastel, huile sur toile (conservée au Ohana Museum of Art, Kurashiki), gouache, gravure sur bois ou monotype[6]. On y voit une jeune femme maorie entièrement nue, cueillant des fleurs dans un paradis luxuriant et coloré. Un lézard aux ailes rouges, à la hauteur de sa tête, incarne ici une figure du mal et lui susurre à l’oreille des paroles tentatrices. L’explication du titre mystérieux, Te nave nave fenua, nous est donnée par Gauguin lui-même dans Noa Noa : « Nave nave fenua. Noanoa. Terre délicieuse. Terre odorante. Délice relevé de je ne sais quelle horreur sacrée que je devine vers l’immémorial. […] Et cette horreur et cette joie incarnées dans L’Ève puissante, fille dorée de ce soleil et de ce sol, qui mêle les parfums du santal et de toutes les fleurs à ceux de sa fière animalité[7]. » Cette Ève d’avant la chute prend les traits de sa maîtresse, qu’il nomme Tehura dans son récit (son nom en réalité Teha’amana). C’est à son sujet qu’il ajoute un peu plus loin : « Paradis tahitien, nave nave fenua… et l’Ève de ce Paradis se livre de plus en plus docile, aimante. Je suis embaumé d’elle : Noanoa[8] ! » Mais si le visage de cette Ève est incontestablement maori, avec son front haut, ses yeux bridés, sa bouche large et ses longs cheveux noirs, la position de son corps est tout droit empruntée à la figure de Bouddha, dans un bas-relief ornant le temple de Borobudur à Java. Car Gauguin emporte avec lui dans son périple « en photographie, dessins, tout un petit monde de camarades qui me causeront tous les jours », explique-il à Odilon Redon avant de partir[9]. Cette photographie a été recueillie par Victor Segalen à Tahiti après la mort de Gauguin, parmi les maigres possessions de l’artiste. Le corps de Bouddha se combine ici aux formes généreuses de la femme maorie dont l’artiste se plaît à décrire l’anatomie dans ces termes : « Une Diane chasseresse qui aurait les épaules larges et le bassin étroit[10]. » Cette Ève syncrétique, mêlant les religions chrétienne, bouddhique et maorie, est aussi un savant mélange de masculin et de féminin, de raffinement et de rudesse. Elle évolue dans un décor synthétique, sorte de symphonie de couleurs vives, évoquant une nature édénique, dont n’émergent pourtant que quelques détails : une fleur haute sur tige, dont la forme évoque les plumes d’un paon. Les traits du visage sont délicatement dessinés d’une pointe de pinceau chargée d’aquarelle bleue, un cerne brun découpe sa silhouette à la manière synthétiste développée par Gauguin et Émile Bernard à Pont-Aven. Les reflets de lumière dans les cheveux et les ombres du cou prennent aussi une teinte cobalt, dans la plus pure tradition impressionniste. Mais ce qui surprend le plus est encore la technique pointilliste qui confère à l’ensemble le scintillement précieux d’une enluminure, chez un artiste résolument critique à l’égard des « petits jeunes chimistes qui accumulent les petits points »[11]. Ce dessin sera par la suite agrandi sous forme de pastel, dans une veine plus synthétique encore, piqueté pour le report sur la toile. La figure à l’échelle se retrouve dans le tableau Te nave nave fenua de 1892 (Ohana Museum of Art, Kurashiki) que l’artiste expose en 1893 à son retour à Paris, chez Durand-Ruel. Le paysage y est plus délibérément descriptif, la figure a des formes plus lourdes et le visage, tourné vers la gauche, accuse des traits d’une autre femme aux cheveux bouclés. L’Ève de Grenoble était peut-être destinée à devenir une page d’un livre, Chez les Maories, Sauvageries, dont l’artiste aurait abandonné le projet. En effet, au dos, de la main de Gauguin, l’inscription « 4 » suggère une pagination. Quant au mot « Paraha », il désigne le Parapha peue en maori (Platax orbicularis), très prisé à Tahiti. En fait, le poisson jaune à tête noire – que l’artiste a délicatement tracé au crayon et rehaussé d’aquarelle – est plutôt un Chaetodon lunula dit aussi Poisson papillon à raies rouges ou chétodon raton laveur, identifié par erreur par Gauguin[12] comme un Paraha peue. On ignore la provenance de ce dessin, depuis le temps de son achat par M. Pietri à Papeete jusqu’au moment où il entre au musée de Grenoble, grâce au legs Agutte-Sembat en 1923.
[1] Paul Gauguin, Noa Noa, manuscrit rédigé en France en 1893-1894, musée d’Orsay (conservé au département des Arts graphiques du Louvre), R. F. 7259, p. 72. Il existe une première version manuscrite de Noa Noa, très peu illustrée, conservée au Los Angeles Getty Museum.
[2] Paul Gauguin prépare soigneusement son voyage en lisant le Mariage de Loti de Pierre Loti, les guides édités par le département des colonies, mais aussi en visitant l’Exposition universelle de 1889. « Je ne vis plus que dans cette espérance de la terre promise », dit-il dans une lettre citée dans Victor Merlhès, dans Les Écrits de Paul Gauguin, 1989, p. 19.
[3] « Pas encore un tableau, mais une foule de recherches qui peuvent être fructueuses, beaucoup de documents qui me serviront pour longtemps, je l’espère en France ». Lettre de Paul Gauguin à Paul Sérusier, Tahiti, novembre 1891, cit. dans Paul Gauguin, Oviri, écrits d’un sauvage, Paris, Gallimard, 1974, p. 77.
[4] Georges Wildenstein, « Vente des œuvres d’art, livres et objets ayant appartenu à Paul Gauguin, 2 septembre 1903 », Gauguin, sa vie, son œuvre, réunion des textes, d’études, de documents, Paris, 1958, p. 207.
[5] Documents Tahiti : 1891, 1892, 1893 (localisation inconnue), Soumin, l’ibis bleu, 1892, (vente Christie’s, Paris, 31 mars 2016, lot. 14) cité dans Nancy Ireson, « Gauguin Paintings, Sculpture and Graphic Works at the Art Institue of Chicago», cat. 43, Chez Les Maories, Sauvageries, 1893, Art Institute of Chicago, Online Scholarly catalogue.
[6] Voir cat. exp. Paris, 1989, cat. 172 a-n et cat. 177-181.
[7] Paul Gauguin, Noa Noa, op. cit., p. 13.
[8] Ibid., p. 107.
[9] Lettre à Odilon Redon, 1890, cit. dans Roseline Bacou et Ari Redon (éd.), Lettres de Gauguin, Gide, Huysmans… à Odilon Redon, Paris, J. Corti, 1960, III, 193.
[10] Paul Gauguin, Oviri, op. cit., p. 325.
[11] Lettre à Mette, mars 1892, Tahiti, cit. dans Paul Gauguin, Oviri, op. cit., p. 78. Gauguin fait ici référence à Signac.
[12] Je remercie ici Catherine Henni pour l'aide apportée dans l'identification de cette espèce.
Découvrez également...
-

Etudes de figures
XVIe siècle -

Eifersucht
1927 -

Portrait d'Olga
1921