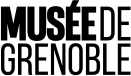Etude de deux cavaliers combattant

Cette feuille est à insérer dans l’important
dossier préparatoire du grand tableau de
bataille du musée du Louvre, commandé à
Salvator Rosa par monseigneur Neri Corsini,
nonce du pape Innocent X en France, et
commencé en août 1652 (inv. 585). L’intention du nonce
était de l’offrir à Louis XIV. Rosa, dans une
lettre datée du 27 août 1652, évoque cette
commande et le peu de goût qu’il avait à
peindre de tels sujets : « Je crois que vous savez
combien je trouve répugnant cette sorte de
sujets, même si c’est un genre dans lequel j’ai à
cœur de surpasser tous les peintres qui
voudraient me concurrencer ; je ne parle pas de
la fatigue extraordinaire qu’exige un tel
ouvrage. [...] Vous savez déjà que j’ai fait
presque vœu de ne plus exécuter de semblables
tableaux, à moins qu’ils ne me soient payés à
l’égal de Raphaël et de Titien. » Le tableau,
terminé en octobre 1652, ne fut pourtant remis
à Louis XIV qu’en août 1664 par le nouveau
nonce, le cardinal Flavio Chigi, et ce en raison
des troubles liés à la Fronde.
Rosa a représenté à plusieurs reprises des scènes
de bataille, malgré le peu d’intérêt qu’il portait
à ce genre, tout attiré qu’il était par des sujets
plus philosophiques ou relevant de la peinture
d’histoire. À Naples, où il s’était formé auprès
du peintre de batailles Aniello Falcone, il a dû
commencer sa carrière en peignant des chocs
de cavalerie et c’est par un tableau de ce type,
daté de 1637, qu’il se fait connaître à Rome.
Le prestige de cette commande, lié à l’importance
de la personne à qui l’œuvre était
destinée, amène Rosa à s’investir pleinement
dans la conception et la réalisation du tableau,
d’autant plus qu’il ne dispose que de quarante
jours (c’est ce que dit Rosa dans sa lettre) pour
mener à bien une composition d’un format
imposant, fourmillant de soldats combattant et
de cavaliers s’entrechoquant dans un tumulte
impressionnant. Il en résulte que son dossier
génétique est le plus riche de toute sa production
peinte. Près de cinquante dessins sont ainsi
conservés, appartenant pour la plupart d’entre
eux au Museum der bildenden Künste de
Leipzig. Aucun dessin d’ensemble n’est curieusement
conservé, ni même des dessins de
groupes de figures. La quasi-totalité des études
parvenues appartiennent à des premières
pensées de figures de combattants, esquissées
fiévreusement sur des feuilles qui semblent
avoir été coupées par le dessinateur lui-même,
avec parfois des reprises de détails. La facture
du dessin de Grenoble est différente de celle qui
caractérise ces feuilles : le trait se fait moins
impétueux et est pratiquement exempt de
reprises. Rosa semble avoir dessiné ici pour
mettre au net de manière toutefois synthétique
des attitudes précédemment étudiées sur
d’autres feuilles[1] (cette netteté va jusqu’à
prévoir le motif ornant le bouclier, figuré sous
la forme d’une ligne serpentante). Les deux
figures ne sont pas pour autant reliées, dirions nous,
diégétiquement entre elles. Elles sont
volontairement isolées : la lance du cavalier du
haut est coupée et le bouclier du cavalier du bas
est dirigé vers une menace mise en réserve à
l’instar de son corps, suspendu dans le vide. Et
pourtant, dans la peinture, ces deux figures sont des cavaliers se faisant face et combattant entre
eux (ils sont situés à senestre) : le cavalier
supérieur est en effet en train d’enfoncer sa
lance dans le corps du cavalier inférieur (fig. 1).
Cette séparation dans l’espace du dessin est tout
simplement un fait d’étude. C’est la pose qui
intéresse Rosa, non la jonction des figures entre
elles. Aussi éloignés qu’ils soient sur la feuille,
Rosa les a cependant réunis. Cette remarque a
son importance car les deux études antérieures
qu’il a sûrement utilisées pour réaliser le dessin
de Grenoble sont des feuilles isolées et
disjointes. Sur la première[2], seul est
dessiné le cavalier du haut, et sur la seconde[3], on y trouve des têtes de cavaliers correspondant
à un cavalier placé à l’extrême droite
du tableau, un morceau d’architecture et la
figure du cavalier se protégeant à l’aide de son
bouclier. Face à un tel chaos de figures, disséminées
sur une multitude de feuilles, Rosa a dû
utiliser une sorte de dessin faisant office de fil
rouge qui, au cours du processus d’étude, a dû
évoluer. Ce dessin ou ces dessins lui servaient
de repère pour reconstituer les groupes de
figures. Tout ce matériel a malheureusement
disparu.
[1] Le dossier génétique de cette peinture conserve d’autres dessins de ce type caractérisés par un tracé plus assuré. Citons en particulier un dessin appartenant à la National Gallery of Scotland d’Édimbourg en rapport avec trois figures de combattants au premier plan à dextre.
[2] Conservé à Leipzig, inv. Nr. NI. 9005.
[3] Conservé à Leipzig, inv. Nr. NI. 9001.