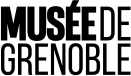Paysage

C’est auprès du conservateur du musée de la céramique de Sèvres que Constant Troyon reçoit son premier enseignement du dessin. La rencontre avec le peintre Camille Roqueplan, qui le met en relation avec la jeune génération de paysagistes comme Jules Dupré , Théodore Rousseau et Paul Huet , luttant pour faire accepter une vision plus réaliste de la nature, lui permet de trouver sa voie. Il peindra désormais en plein air, sur le motif, et la forêt de Fontainebleau sera son territoire d’élection. Mais après un voyage en Hollande en 1847 et la découverte des peintures animalières d’Albert Cuyp et Paulus Potter, Constant Troyon introduit de plus en plus de portraits d’animaux au sein de ses paysages. Au fil du temps, ceux-ci deviendront le vrai sujet de ses peintures, la nature étant réduite à une simple toile de fond. Comme le souligne son élève Émile Van Marcke, « Pour obtenir les tons frais des Hollandais, il employait des couleurs à l’état natif. Pour maintenir l’harmonie constante entre elles, il menait tout de front : le paysage, les bêtes, les lumières, les ombres, le ciel, piquant une touche ici, puis là, partout.[1]» Peintre de la vie rurale, de l’harmonie de l’homme et de la nature, il devient vite un spécialiste de la peinture animalière à la réputation bien établie et au carnet de commandes bien rempli, ce qui lui vaut le surnom de « Paulus Potter français ». Il excelle en particulier dans les études de vaches, moutons, chiens ou chevaux, qu’il réalise à la peinture à l’huile, au pastel ou au fusain. Son atelier, comme nous l’indique Philippe Burty, comporte à son décès des « cartons pleins de dessins de toute sorte.[2] » À côté des études sommaires d’animaux ou de sites ruraux, rapides, préparatoires à des tableaux, on trouve aussi dans sa production graphique – répertoriée précisément dans l’ouvrage de Louis Souillé[3] –, de grands dessins au pastel ou au fusain rehaussé de craie blanche, très aboutis, qui ne semblent pas avoir été destinés à être traduits à l’huile. Certains, comme le dessin de Grenoble envoyé par l’État en 1896, sont signés et donc probablement destinés à la vente. Dans cette grande feuille, l’artiste utilise la teinte chamois du papier comme une couleur supplémentaire dans sa palette. Jouant de toutes les nuances du fusain, du noir le plus profond au gris le plus léger, il parvient à rendre la légèreté des feuillages, leur articulation sur le tronc central de l’arbre selon l’architecture propre à chaque espèce. Ne cherchant pas le détail des branches ou des feuilles, l’artiste joue sur les valeurs pour donner l’illusion du volume. La trouée entre les deux futaies dessine un chemin où pénètre la clarté du ciel, rendue plus lumineuse par les rehauts de craie blanche. La forêt est ici comme un décor devant lequel se déroulent quelques scénettes champêtres : un berger avec son troupeau, deux hommes discutant près d‘une barrière, une femme tenant son enfant par la main et un homme de dos, à l’orée du bois. La forêt n’est plus ici un coin de nature vierge, où l’âme de l’artiste se perd, elle est un lieu de vie, hospitalier, but de promenade ou siège d’activités agricoles. « Le travail incomparable de Troyon consiste à exprimer la présence de l’air, à plonger les figures dans un bain de lumière. Sa touche pâteuse, habilement indécise, dévore les contours et les habille d’atmosphère », nous dit Charles Blanc pour décrire l’harmonie sereine qui se dégage de ses œuvres.
[1] Cité par Robert de La Sizeranne, « Une heure à la collection Chauchard », Revue des Deux Mondes, 6e période, t.1, 1911, p. 587-609.
[2] Préface du catalogue de la vente après décès de l’artiste qui se tient en 1865. Rééditée dans Louis Soullié, Les grands peintres aux ventes publiques, I., Constant Troyon, Paris, mai 1900.
[3] Ibid., p. 179 à 218.
Découvrez également...
-

-

Coupe
fin XVIIIe siècle -